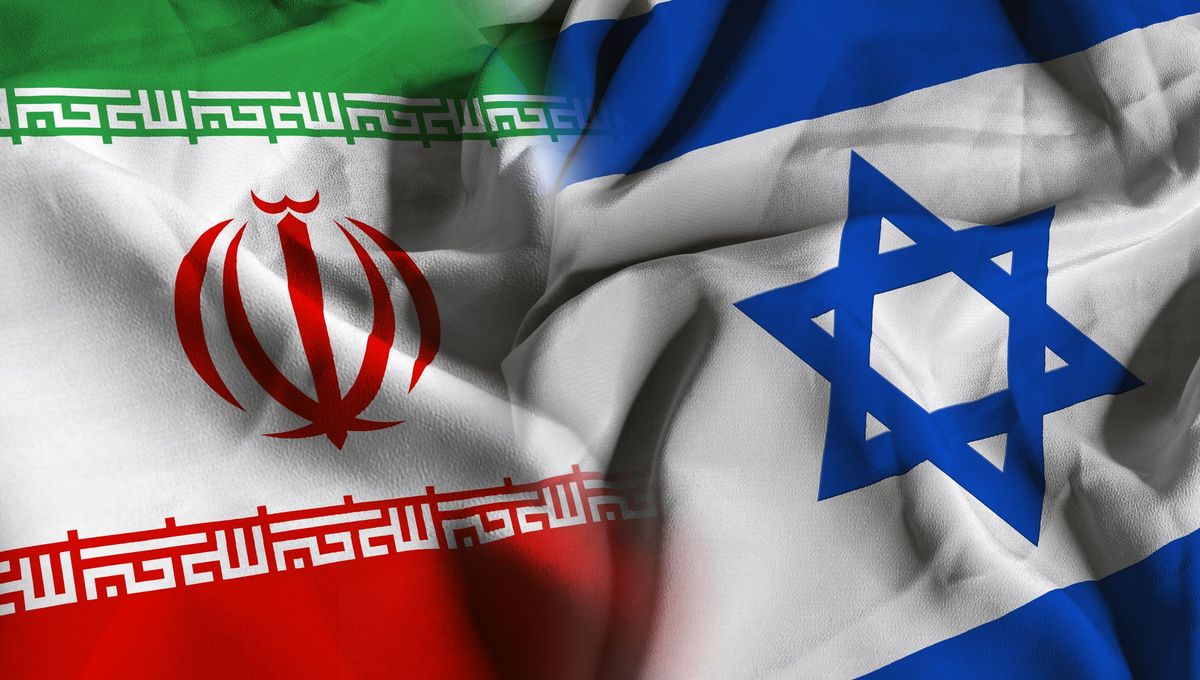Israël - Iran : stop à l'escalade !
Une semaine après le début des hostilités entre Israël et l’Iran, qui nous bouscule nous mais aussi l’ordre international, il faut prendre un peu de recul pour analyser sereinement la situation et les conséquences potentielles majeures pour l’équilibre du Moyen-Orient et du monde.
Je vais commencer par dire les choses clairement : les frappes lancées par le gouvernement israélien sur l’Iran le 13 juin dernier sont en violation claire du droit international. Vous allez me dire que Benjamin Netanyahou n’en est pas à une violation près du droit international, mais cette nouvelle agression plonge un peu plus encore la région dans le chaos. Et comme d’habitude, ce sont les populations civiles, en Iran comme en Israël, qui sont les premières à payer le prix des folies meurtrières. Le bilan est déjà terrible : 639 morts iraniens et 1 329 blessés, ainsi que 24 morts israéliens et plus de 824 blessés.
Benjamin Netanyahou a fait une pierre deux coups : il a saboté les négociations sur le programme militaire nucléaire iranien avec les États-Unis, et a obtenu l’annulation de la conférence à New York, organisée par la France et l'Arabie Saoudite sur la reconnaissance de l’État de Palestine. Car c’est bien là son objectif premier : faire diversion du génocide qu’il est en train de commettre dans la bande de Gaza.
Et force est de constater que son opération est réussie : il n’est plus question du martyr des Palestiniens dans les médias (qui avaient déjà tant de mal à s’intéresser au sort de la Palestine), les Occidentaux se sont précipités pour afficher leur soutien à Israël, et la reconnaissance de l’État de Palestine par de nombreux États, dont la France, est reportée aux calendes grecques.
Mais contrairement à ce qu’avance Macron sur le « droit d’Israël à se défendre », l’article 51 de la Charte des Nations Unies conditionne ce droit à une agression armée préalable. Israël réinvente la guerre préventive, celle-là même qui avait conduit à la catastrophique invasion de l’Irak en 2003, comme si aucune leçon n’avait été apprise des erreurs commises à ce moment-là.
Décidément, les chancelleries occidentales ont perdu toute boussole du droit international depuis 1981, date à laquelle Israël a bombardé un réacteur irakien. Le Conseil de sécurité, dans sa résolution S/RES/487, avait alors condamné « énergiquement l’attaque militaire menée par Israël, en violation flagrante de la Charte des Nations Unies et des normes de conduite internationale ».
Mais plutôt que de condamner l’agression israélienne, Macron n’a rien trouvé de mieux que de proposer le soutien des forces armées françaises à Israël. L’incohérence diplomatique française, qui s’oppose désormais au changement de régime iranien, ne permet pas à la France d’être un acteur crédible pour créer un cadre diplomatique multilatéral permettant une solution négociée au conflit. Les États-Unis, de leur côté, hésitent pour l’heure à saisir l’opportunité stratégique offerte par l’affaiblissement du régime iranien et le recul de ses proxys dans la région pour frapper unilatéralement les installations nucléaires iraniennes en profondeur. Des frappes qui pourraient provoquer des rejets radioactifs ayant des conséquences graves en Iran comme au-delà.
Que les choses soient claires : jamais vous ne nous trouverez du côté des mollahs iraniens, qui bafouent allègrement les droits des femmes, des personnes LGBT et de tout opposant. Nous les avons toujours activement combattus et continuerons de le faire.
Mais quelle intervention militaire pour faire tomber un régime autoritaire a permis d’installer durablement la démocratie ? L’Irak ? L’Afghanistan ? La Libye ? Aucune. Car il est clair, à cette heure, qu’il n’est plus seulement question de l’arme nucléaire, et que l’objectif d’Israël et des États-Unis est tout autre. Pourquoi, sinon, le gouvernement israélien aurait-il lancé ses frappes quelques jours à peine avant la reprise des négociations sur l’accord nucléaire, et aurait assassiné le négociateur principal iranien ?
La question de la prolifération de l’arme nucléaire n’en demeure pas moins essentielle. À noter tout d’abord que le gouvernement israélien est la seule puissance nucléaire de la région, mais il n’a pas ratifié le traité international de non-prolifération des armes nucléaires, et se trouve par conséquent très mal placé pour donner des leçons en la matière.
Cela fait 30 ans que les gouvernements israéliens successifs avertissent régulièrement que l’Iran est sur le point de se doter de l’arme nucléaire, pour justifier son emploi de la force. Il feint de ne pas savoir que si l’Iran a enrichi son uranium à des taux supérieurs à ceux nécessaires à des usages civils, c’était aussi pour établir un rapport de force régional, en se dotant d’une ambiguïté stratégique de « pays du seuil » — c’est-à-dire un pays ayant la capacité inquiétante de se doter de l’arme nucléaire sans, pour l’instant, franchir la ligne rouge. Pour l’heure, l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) n’a pas été en mesure de déterminer si le programme nucléaire iranien était « exclusivement pacifique », et la directrice du renseignement américain estime que « l’Iran ne construit pas d’arme nucléaire et que le Guide suprême Khamenei n’a pas autorisé le programme d’armes nucléaires suspendu en 2003 ». Cela n’enlève rien à la menace principielle que fait peser la République islamique d’Iran sur Israël, en le menaçant régulièrement, dans sa rhétorique, de destruction totale.
La paix et la sécurité du monde sont en jeu. Il n’y a aucune solution militaire aux conflits, mais uniquement des solutions diplomatiques, avec pour préalable un accord de cessez-le-feu entre les belligérants. C’est à l’Europe de saisir l’opportunité laissée par la position belliciste des États-Unis : le format P5+1 (Conseil de sécurité des Nations Unies + Allemagne) négociant avec l’Iran a permis d’aboutir à l’accord de Vienne. Cet accord avait été scrupuleusement respecté par l’Iran jusqu’à ce que les États-Unis l’aient dénoncé unilatéralement. C’est ce format qui permettrait une nouvelle initiative diplomatique pour la non-prolifération des armes atomiques au Moyen-Orient, et la paix et la sécurité des peuples avant octobre 2025, date qui marque la fin de l’application de l’accord de Vienne.
Encore faut-il que les États européens sortent de leur aveuglement diplomatique, qui les enferme dans un suivisme des États-Unis de Donald Trump. Au nom de mon groupe de La Gauche que je préside au Parlement européen, j’ai demandé cette semaine qu’une résolution puisse être votée au Parlement européen pour dénoncer les violations du droit international et appeler à la désescalade. Demande rejetée par la majorité des autres groupes politiques, des socialistes jusqu’à l’extrême droite. La lâcheté semble désormais être devenue la norme en relations internationales. Quand ce n’est pas la complicité.